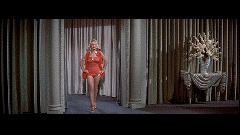-
Par Dona Rodrigue le 14 Avril 2012 à 15:10

Interview
C'est par l'intermédiaire de Ruppert Allan, chargé de la promotion de Marilyn, qu'eut lieu en 1960 la grande interview entre Marilyn Monroe et Georges Belmont.Ce dernier était alors rédacteur en chef de la revue Marie-Claire. L'interview se déroula pendant le tournage du film Le milliardaire qui connut un succès particulier en France en raison de l'interprétation d'Yves Montand.
MARILYN MONROE : J'aimerais mieux répondre à des questions. Je ne sais pas raconter, c'est terrible... par ou commencer? comment? Il y a tant de ramifications...GEORGES BELMONT : Tout de même, il y a eu un commencement : votre enfance.
MARILYN MONROE : Même cela, personne n'en saurait rien, sans un pur hasard. Longtemps, mon passé, ma vie sont restés totalement inconnus. Jamais je n'en parlais. Sans raison particulière.Simplement, je trouvais que c'etait mon affaire et pas celle des autres.Puis un jour, un M. Lester Cowan a voulu me mettre dans un film avec Groucho Marx, LOVE HAPPY. J'avais déjà été sous contrat avec la Fox et la Columbia, à l'époque, mais saquée... C'était un petit rôle qu'il m'offrait, ce M. Cowan, mais il tenait à m'avoir sous contrat.Donc, il téléphone. J'etais encore très jeune et il me dit qu'il voulait parler à mon père et à ma mère. Je lui dis : "Impossible." - "Pourquoi?" insiste-t-il. Je lui ai expliqué alors brièvement la chose : "Je n'ai jamais vécu avec eux." C'était la vérité et je ne vois toujours pas ce que cela avait de sensationnel.Mais il téléphona à la chroniqueuse Louella Parsons et lui raconta toute l'histoire.Cela parut dans la "colonne" de Louella. C'est comme ça que tout a commencé. Depuis, on a débité tant de choses fausses que, mon Dieu, oui, pourquoi ne pas dire la vérité maintenant?
GEORGES BELMONT : Quelles sont les premières images de vous, enfant, que vous gardiez?
MARILYN MONROE (long silence) : Mon premier souvenir?...C'est un souvenir de lutte pour la vie. J'etais toute petite... un bébé dans un petit lit, oui, et je luttais pour ma vie. Mais j'aimerais mieux ne pas en parler, si cela vous est égal : c'est une chose cruelle qui ne regarde que moi et personne d'autre, comme je disais.Ensuite, aussi loin que je remonte, je me revois dans une poussette, en longue robe blanche, sur le trottoir de la maison ou je vivais dans une famille qui n'etais pas la mienne. C'est un fait que je suis une enfant naturelle. Mais tout ce que l'on a dit de mon père, ou de mes pères, est faux. Le premier mari de ma mère s'appellait Baker. Le second, Mortenson.Mais elle avait depuis longtemps divorcé d'avec les deux quand je suis née. On a raconté que mon père était norvégien, sans doute à cause du nom Mortenson, et qu'il était mort dans un accident de moto, peu après ma naissance. J'ignore si c'est vrai de Mortenson, n'ayant jamais eu de lien de parenté avec lui.Quant à l'indentité de mon vrai père, là encore, si vous le voulez bien, je vous prierai de ne pas m'interroger ; cela n'intéresse que moi. Cependant, il y a deux faits qui peuvent expliquer certaines... confusions. D'abord, on m'a toujours dit dans ma petite enfance que mon père s'était tué dans un accident d'automobile à New York, avant ma naissance.Ensuite, curieusement, mon bulletin de naissance porte, en réponse à une mention "Profession", le mot Baker, qui était le nom du premier mari de ma mère, mais qui veut dire aussi "boulanger". Quand je suis née, enfant naturelle ainsi que je l'ai dit, ma mère devait me donner un nom. Mon sentiment est que, forcée de penser vite, elle donna : "Baker". Pure coincidence, puis confusion de la part de l'officier d'état civil... C'est du moins ce que je pense.GEORGES BELMONT : Votre mère... J'ai lu quelque part que, pour vous, elle n'était que "la femme aux cheveux roux"?MARILYN MONROE : Je n'ai jamais vécu avec ma mère.On a dit le contraire, mais cela seul est vrai. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j'ai toujours vécu en pension chez des gens. Ma mère avait des... troubles mentaux. Elle est morte maintenant. Mes grands-parents maternels sont morts tous les deux fous, enfermés.Ma mère, aussi, il fallut l'interner. Elle sortait parfois, et puis elle... rechutait.Alors, vous savez comme c'est... toute petite, je disais en montrant la première femme venue : "Oh! une maman!", et le premier homme : "Oh!un papa!". Mais un matin, je devais avoir trois ans, pas plus, on me baignait et je dis "maman" à la femme qui s'occupait de moi à l'époque.Elle me répondit : "Je ne suis pas ta maman. Appelle-moi 'tante'." - "Mais lui est mon papa?" dis-je ne montrant son mari.- "Non", me dit-elle. "Nous ne sommes pas tes parents. Celle qui vient te voir de temps en temps, la femme aux cheveux roux, celle-là est ta maman." Ce fut un choc d'apprendre cela, mais comme elle venait très rarement, c'est vrai que pour moi elle resta surtout "la femme aux cheveux roux".Tout de même, j'essayais qu'elle existait. Seulement, plus tard, quand on me mit dans un orphelinat, j'ai eu un autre choc. Je savais lire, alors. Quand j'ai lu "orphelinat" en lettres d'or sur fond noir, il a fallu me traîner, je hurlais : "Je ne suis pas une orpheline! J'ai une maman!" Mais par la suite, j'ai fini par penser : "Il faut croire qu'elle est morte... "Et, plus tard encore, des gens me disaient :"Ta mère, mieux vaut que tu l'oublies." - "Mais ou est-elle?" demandais-je.- "N'y pense plus, elle est morte." Après quoi, tout à coup, j'avais de ses nouvelles...Et il en fut ainsi pendant des annèes.Je la croyais morte et je le disais. Et elle vivait. Ce qui fait qu'on a prétendu que j'avais inventé qu'elle était morte, parce que je ne voulais pas avouer ou elle était. Idiot!En tout cas, j'ai eu... attendez que je compte... dix, non onze "familles". La première vivait dans une petite ville du comté de Los Angeles ; je suis née à Los Angeles. Il y avait avec moi un petit garçon que ces gens adoptèrent ensuite.Je suis restée avec eux jusqu'à l'âge de sept ans environ. Ils étaient affreusement sévères. Sans méchanceté. C'était leur religion. Ils m'élevèrent à leur manière, durement, en me corrigeant souvent comme on ne devrait jamais le faire, à mon avis : à coup de ceinturon de cuir. Finalement, cela se sut ; on me retira pour me confier à un couple anglais, à Hollywood.Ceux-là étaient des acteurs, des figurants plutôt, avec une fille de vingt et un ans qui était la doublure de Madeleine Carroll. Chez eux, c'était la vie sans souci, et assez tumultueuse. Cela me changeait de la première famille ou on ne pouvait même pas parler de cinéma ou d'acteurs, ni de danser ou de chanter, sauf des psaumes. Mes "nouveaux parents" travaillaient dur, quand ils travaillaient et jouissaient de la vie le reste du temps.Ils aimaient danser, chanter, boire, jouer aux cartes et avoir beaucoup d'amis. Avec l'éducation religieuse que j'avais reçue, j'étais terrifiée : je les voyais tous en enfer! Je passais des heures à prier pour eux. Je me rappelle une chose... au bout de quelques mois, je crois, ma mère acheta une petite maison ou tout le monde alla vivre. Pas pour longtemps ; trois mois au plus. Cette fois encore, ma mère dut être... emmenée. Et même pendant ces trois mois, je la vis à peine. Bref, ce fut un grand changement.Après son départ, nous regagnâmes Hollywood. Ces anglais me gardèrent tant qu'il y eut de l'argent... l'argent de ma mère, de ses biens et d'une assurance qu'elle avait souscrite. C'est avec eux que j'ai fait la connaissance du cinéma. Je n'avais pas huit ans. Ils me déposaient devant une des grandes salles d'Hollywood, L'Egyptien ou le Grauman's Chinese tôt le matin.Toute seule, je regardais les singes en cage devant l'Egyptien, ou j'essayais de placer mes pieds dans les moulages de ceux des stars, à l'entrèe du Grauman's : mais je n'y arrivais jamais, j'avais de trop grands souliers...C'est drôle de penser que mes empreintes y sont, et que maintenant d'autres petites filles font peut-être comme moi autrefois. Ils me conduisaient donc là chaque samedi et dimanche. C'était repos pour eux et j'imagine qu'ils ne voulaient pas s'encombrer d'un enfant à la maison. D'ailleurs, cela valait probablement mieux pour moi.J'attendais l'ouverture, je donnais mes dix cents et m'installais au premier rang. J'ai vu toutes sortes de films comme cela. Je me souviens de CLEOPATRE, avec Claudette Colbert. Je restais là, tard, séance après séance. J'étais censée rentrer avant la nuit. Mais comment pouvais-je savoir quand c'était la nuit?! Et puis, on était bien ; et même si je ne pouvais rien acheter quand j'avais faim, je savais qu'on me garderait de quoi manger. Alors, je restais. J'avais mes stars préférées.Jean Harlow!... Mes cheveux étaient platines ;on m'appelait "Tête d'étoupe". Je détestais ça, je rêvais de cheveux blond doré... jusqu'à ce que je l'ai vue : si belle, et platine, comme moi!... Et Clark Gable! J'éspère qu'il ne m'en voudra pas si je dis que je voyais en lui mon père, je n'étais qu'une gamine, et, d'après Freud, il n'y a pas mal à cela,au contraire!Je rêvais que mon père lui ressemblait, ou même qu'il était mon père... ce qui me rappelle que c'est curieux, mais je n'ai jamais rêvé que personne fût ma mère... Ou en étais-je?!GEORGES BELMONT : Le couple anglais. Quand il n'y a plus eu d'argent...MARILYN MONROE : Oui. On m'a mise à l'orphelinat. Oh! mais, attendez! Oh!... non! Quand ces anglais n'ont plus pu me garder, je suis allée vivre chez des gens à Hollywood. Des gens de la Nouvelle-Orléans. Je m'en souviens parce qu'ils pronoçaient "New Orlinns". Mais je n'y suis pas restée longtemps. Trois quatre mois. Je me rappelle seulement que le mari était opérateur de cinéma et que, tout à coup, on m'a conduite à l'ophelinat. Je sais, certains prétendent que ce n'était pas un endroit si affreux.Mais je sais aussi que la maison a beaucoup changé ; peut-être est-ce moins sinistre à présent... bien que l'orphelinat le plus moderne du monde demeure un orphelinat, si l'on voit ce que je veux dire. La nuit, quand les autres dormaient, je restais à la fenêtre du dortoir et je pleurais parce que, loin et haut par-dessus les toits, je voyais briller les lettres des studios R.K.O. et que ma mère y avait travaillè come monteuse.Des annèes après, en 1951, quand je tournais "CLASH BY NIGHT" pour R.K.O., je suis montée là-haut pour essayer de voir l'orphelinat ; mais il y avait de trop grands buildings. J'ai lu je ne sais où que nous n'étions pas plus que trois ou quatre par chambre dans cet orphelinat. C'est faux. J'étais dans un dortoir de vingt-cinq lits, dont on pouvait faire le tour si on le méritait, en remontant du lit n°1 au lit n°27, qu'on appelait le "lit d'honneur".Et du 27, si l'on était très sage, on pouvait espérer passer dans un autre dortoir avec moins de lits. J'y ai réussi une fois. Mais un matin où j'étais en retard, je pense, et où je laçais mes chaussures, la surveillante me dit : "Descendez!" Je tentai de lui expliquer : "Mais il faut que j'attache mes souliers!" Elle me foudroya : "retour au lit n°27!". Le lever était à 6 heures et nous devions faire certaines corvées avant d'aller à l'école. Nous avions chacune un lit, une chaise et une armoire.Tout cela devait être très propre, astiqué, à cause des inspections à l'improviste. J'ai nettoyé le dortoir pendant un temps. Tous les jours bouger les lits, balayer, épousseter. Les salles de bain, c'était plus facile : moins de poussière, à cause du sol en ciment. J'ai travaillé également aux cuisines.Je lavais la vaisselle. Nous étions cent : je lavais donc cent assiettes et autant de cuillères et de fourchettes... pas de coutaux ni de verres ; nous buvions dans les quarts. Seulement, à la cuisine, on gagnait des sous : cinq cents par mois et à cela après qu'on vous retenait un cent pour l'école du diamanche. Bref, on se retrouvait avec un cent au bout du mois, s'il n'y avait que quatre dimanches ; de quoi acheter peut-être un petit cadeau pour sa meilleure amie, à Noel, en économisant. Je ne peux pas dire que j'étais très heureuse. Je n'étais pas bien avec les surveillantes.Mais la directrice était très gentille. Je me souviens qu'un jour, elle me fait appeller dans son bureau et me dit : "Vous avez une très jolie peau, mais un peu luisante. Nous allons y mettre un soupçon de poudre, pour voir."Je me sentais honorée d'être là. Elle avait un petit pékinois qu'on empêchait d'aller avec les enfants parce qu'il les mordrait, mais qui me fit des tas d'amitiés.Comme j'adorais déjà les chiens, imaginez!... J'étais si honorée, vraiment, que je marchais dans les airs. Un peu plus tard, j'ai voulu m'évader avec d'autres camarades. Pour aller où? Nous n'en avions pas la moindre idée. Le temps de traverser une grande pelouse, nous étions déjà rattrapées.Quand on me ramena, je suppliais : "Ne le dites pas à la directrice!" - parce que je la voyais encore me sourire en me tapotant le nez avec sa houpette, et parce qu'elle m'avait laissé caresser son petit chien. Même maintenant, cela revient parfois, quand je suis trop nerveuse ou surexcitée.Une fois, j'avais un petit rôle, avec une scène où je devais gravir un escalier ; j'ai oublié ce qui arriva, mais le metteur en scéne assistant se précipita vers moi en me criant des mots et j'en fus si bouleversée que, au moment de la reprise, impossible de dire la réplique!Rien qu'un affreux bafouillis. Sur quoi, le metteur en scène, furieux, se précipite à son tour et crie :"Tout de même, vous ne bégayez pas?" - "V-v-vous croyez ça?" lui ai-je dit. C'était horrible! Et ça l'ai encore, quand je parle trop vite ou quand je dois faire un discours. Pénible!... (Silence) Je voudrais qu'on en ai fini avec cette partie de ma vie... (Silence) Je suis restée environ un an et demi dans cet orphelinat.Nous allions à l'école. C'est très mauvais pour les enfants d'une institution comme celle là, d'aller à l'école publique. Les autres nous montraient du doigt et serinaient : "Oh, v'là les orphelins!" Nous avions honte. A l'école, j'aimais bien le chant et l'anglais.Je détestais le calcul ; je n'avais pas l'esprit à ça ; pendant les leçons, mes rêves s'envolaient par la fenêtre. Mais j'étais bonne en gymnastique et en sport. J'étais très grande.A l'orphelinat, le premier jour, on n'a pas voulu me croire quand j'ai dit mon âge : neuf ans. On m'en donnait quatorze.Je mesurais presque ma taille actuelle : 1m63.Mais j'étais très maigre jusqu'à onze ans, où les choses ont changé. Je n'étais plus à l'orphelinat, à cet âge. Je m'étais tellement plainte à ma tutrice qu'elle me sortit de là. C'était une vieille amie de ma mère. Grace McKee.Elle est morte il y a onze ans. A l'époque où elle était devenue ma tutrice, elle était chef monteuse chez Columbia.Puis on la renvoya et elle a épousé alors un homme de dix ans plus jeune qu'elle et père de trois enfants. Ils étaient très pauvres et, pour cela, ne pouvaient s'occuper de moi.En outre, je pense qu'elle estimait que son premier devoir allait à son mari et aux enfants de celui-ci, ce qui est normal. Néanmoins, elle était merveilleuse pour moi, à bien des égards. Sans elle, j'aurais pu me retrouver Dieu sait où, à l'Assistance Publique jusqu'à 18 ans. A mon orphelinat, qui était privé, elle venait me voir et me sortait. Pas souvent, mais tout de même... cela me donnait du courage.Je n'avais que neuf ou dix ans, et elle me laissait jouer avec son rouge à lèvres ou me menait chez le coiffeur pour une ondulation... chose inouie, d'abord parce que c'était interdit, et puis parce que j'avais les cheveux raides : alors vous imaginez ce que cela représentait!De plus, c'est elle qui me retira de l'orphelinat, après mes plaintes, ainsi que je l'ai dit. Naturellement, cela signifia d'autres "familles". Je me souviens d'une où je restais trois ou quatre semaines. Je m'en souviens à cause de la femme qui allait livrer des choses que son mari fabriquait.Elle m'emmenait avec elle, et oh! la voiture me rendait si malade!... J'ignore si on les payait pour me garder. Je sais seulement que, après eux, j'ai tout le temps changé de maison. Certaines familles me prenaient à la fin d'un trimestre scolaire et en avaient assez, après les vacances ; ou peut-être étais-ce l'arrangement. Par la suite, le comté de Los Angeles m'a prise en charge.C'était pire : je détestais ça. Même à l'orphelinat, quand j'allais à l'école, j'essayais toujours de ne pas avoir l'air d'une orpheline. Mais maintenant, une femme arrivait et disait : "Voyons, voyons... lève les pieds" et elle marquait : "Paire de chaussures".Puis : "A-t-elle un chandail?" Ou encore : "Je crois que la pauvre fille aurait bien besoin de deux robes, une pour l'école, une pour le dimanche. "Et les chandails étaient en coton et laids, les robes semblaient taillées dans de la toile de sac... Terrible! Et les chaussures!Je disais : "Je n'en veux pas!" Je m'arrangeais toujours pour me faire donner des robes, des robes de grandes personnes qu'on recoupait à ma taille.Et la plupart du temps j'avais des souliers de tennis : on en trouvait pour moins d'un dollar. Je devais être une drôle de fille, à cette époque. Très grande, comme je l'ai dit. Pas grimacière pour la nourriture. Mangeant de tout. Je le sais parce que, dans presque toute les familles, on disait que jamais on avait vu une enfant aussi peu difficile. Je sais aussi que j'étais très tranquille, avec les grandes personnes en tout cas. On m'appelait "la souris".Je parlais peu, sauf quand j'étais avec d'autres gosses. Alors je n'étais plus la même. Ils aimaient jouer avec moi. J'avais de l'invention ; je disais : "On joue au divorce, au crime!" et eux me regardaient : "Mais où vas-tu prendre ça?". J'étais probablement très différente des autres.Alors que les enfants refusent en général d'aller se coucher, jamais je ne rechignais. Au contraire, de moi-même je disais : "Je crois que je vais aller me coucher." J'aimais la solitude de ma chambre, et mon lit. J'aimais surtout me jouer le dernier film que j'avais vu. Debout sur mon lit, plus grande que jamais, je jouais tous les rôles, y compris ceux des hommes, et j'ajoutais des inventions de mon cru. J'adorais cela, tout comme jouer la comédie dans les fêtes scolaires.Là, toujours à cause de ma taille, j'ai joué le roi une fois, et une autre fois le prince. J'ai eu une période heureuse, dans cette partie de ma jeunesse : celle où j'ai vécu chez "tante" Anna. C'était une vielle femme de soixante ou soixante-cinq ans, parente de Grace McKee. Elle m'aimait beaucoup et j'y étais très sensible.Elle me comprenait. Elle n'oubliait jamais qu'elle avait été jeune et ses merveilleuses histoires, tristes ou gaies, de ce temps passé me fascinaient. Le soir, quand je faisais la vaisselle, j'étais si heureuse que je chantais ou sifflais par la fenêtre de la cuisine, et qu'elle disait : "Quel pinson!Je n'ai jamais rien entendu de pareil!". C'est vers la fin de cette période qu'on m'a mariée. Il y a peu de choses à dire de ce mariage. Grace McKee et son mari devaient partir pour la Virginie.A Los Angeles, ils touchaient vingt dollars du comté pour moi ; si je partais avec eux, nous perdions cet argent. Comme ils n'étaient pas assez riches pour me faire vivre mais qu'ils m'aimaient bien, il fallait trouver un moyen de me "caser".En Californie, une jeune fille peut se marier à seize ans.On m'a donc donné le choix : ou entrer dans un Orphelinat d'Etat jusqu'à dix-huit ans ou me marier. J'avais presque seize ans ; j'ai choisi le mariage. Il s'appelait Dougherty, il avait vingt et un ans et travaillait dans une usine. Peu de temps après, ce fut la guerre.D'abord mobilisé comme moniteur d'éducation physique, il fut versé ensuite dans l'armée active, mais échoua finalement dans la marine marchande. Peu avant la fin de la guerre, j'allais à Las Vegas et obtins le divorce. J'avais vingt ans. Aujourd'hui, il est agent de police. J'ai travaillé en usine pendant la guerre. J'ai commencé par vérifier des parachutes, pour avions-cibles, pas pour hommes.Puis, je suis passée au "collage", comme on appelait ça... un enduit qu'on étalait sur ce qui servait à fabriquer les avions-cibles. C'était fastidieux et il y avait une mauvaise ambiance humaine.Les femmes parlaient surtout de l'emploi de leurs soirées et du prochain week-end. Je travaillais tout près de l'atelier de peinture au pistolet... rien que des hommes. Ils m'écrivaient des mots et s'arrêtaient de peindre, etc. C'était si monotone que je travaillais vite, pour me débarrasser.Le résultat fut inattendu.On a dû trouver que j'abattais un travail formidable. Il y a eu une assemblée générale du personnel et le directeur m'a citée pour "bonne volonté exemplaire" et m'a remis un insigne en or et un bon du Trésor de vingt-cinq dollars. Les autres filles ont été folles de jalousie et m'ont mené la vie dure, après cela. Elles ricanaient et faisaient exprès de me bousculer quand j'allais remplir mon pot d'enduit ; pour le renverser sur moi. Oh, j'ai souffert!Et puis, un jour l'Armée de l'Air a voulu des photos de notre usine. Je revenais d'un congé, on m'appelle au bureau : "Où vous cachiez-vous?" Morte de peur, je réponds : "J'étais en permission régulière!"- ce qui était vrai. On me dit : Là n'est pas la question. Voulez-vous poser pour des photos?" Bref, les photographes arrivèrent et prirent des photos. Ils en réclamèrent d'autres, hors de l'atelier.Moi, j'avais peur de m'attirer des ennuis si je quittais mon travail. J'ai refusé, j'ai dit : "Demandez la permission." Ils l'ont obtenue et j'ai passée plusieurs journées à poser ici, là, et à tenir des trucs, pousser des trucs, tirer des trucs... Les photos étaient développées dans les laboratoires Eastman-Kodak. Et là, les gens ont demandé qui était le modèle et en ont parlé aux photographes ; si bien que l'un d'eux - David Conover - est revenu me dire : "Vous devriez faire le modèle.Vous gagneriez facilement cinq dollars de l'heure. "Cinq dollars de l'heure, alors que j'en gagnais vingt par semaine, pour dix heures de travail par jour, les pieds sur le ciment! Il y avait de quoi tenter la moins folle des filles. Je m'y suis mise peu à peu. C'était la fin de la guerre. J'ai quitté l'usine. Je me suis présentée à une agence. J'ai eu du travail. Photos publicitaires. Calendriers...Pas celui qui a fait tant de bruit ; nous y viendrons. D'autres, où j'étais brune, rousse, blonde. Et je gagnais vraiment cinq dollars de l'heure! De temps à autres, je pouvais réaliser un de mes rêves : me payer des leçons d'art dramatique... quand j'avais assez d'argent, car ça coûtait cher, dix dollars de l'heure! Je faisais la connaissance de gens très différents de ce que j'avais connus jusqu'alors. Des bons et des mauvais. Souvent, quand j'attendais un bus à un coin de rue, une voiture s'arrêtait et l'homme au volant me débitait une histoire : "Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous devriez être dans les films." Ensuite il proposait de me ramener.Moi, je répondais toujours : "Non merci. J'aime mieux le bus." Mais tout de même, l'idée du cinéma cheminait dans ma tête. Une fois, je me souviens, j'ai accepté un rendez-vous dans un studio avec un homme rencontré de cette façon. Il devait être très persuasif. J'y suis allée.C'était un samedi et il n'y avait pas un chat dans ces studios. J'aurais dû me méfier, mais j'étais naive à bien des points de vue. Bref, je trouve mon homme qui me conduit dans un bureau. Nous étions seuls.Il me tend un scénario en disant que je devrais faire l'affaire pour un rôle, mais qu'il faut voir. Sur quoi, il me demande de lire le rôle, tout en insistant pour que je relève ma robe et que je la garde comme ça. C'était en été et j'avais un maillot de bain sous ma robe.Mais comme il répétait : "Plus haut!" j'ai pris peur et, toute rouge, je me suis entêtée de mon côté : "Seulement si je garde mon chapeau!" C'était idiot, mais j'avais vraiment peur et j'étais déséspérée. Je devais être ridicule, assise là et cramponnée à mon chapeau. A la fin, il s'est mis en fureur, ce qui a achevé de me terrifier, je me suis sauvée et j'ai signalé l'affaire à l'agence.On a téléphoné aux studios, et ailleurs, pour essayer de le retrouver. Impossible. Il devait avoir un ami dans la place qui lui avait permis d'utiliser son bureau. L'incident me bouleversa à tel point que, pendant assez longtemps, je résolus de ne jamais être actrice. C'est une dure époque de ma vie. Je déménageais tout le temps, d'un meublé à l'autre.L'hôtel était trop cher. Et puis le hasard a fait qu'on m'a vue sur la couverture de cinq magasines différents le même mois et la Fox a téléphoné. Je me suis retrouvée sur un banc de bois avec des gens de tout âge et de toutes dimensions qui attendaient comme moi.On a attendu lontemps avant que Ben Lyon, qui dirigeait le recrutement, sorte de son bureau. A peine sorti, il a dit en me montrant du doigt : "Qui est-ce?" Je portais une petite robe blanche en piqué que "Tante" Anna - j'étais revenue vivre chez elle quelque temps - avait lavée et repassée à toute vitesse ; tout cela était arrivé si rapidement que je n'aurais jamais pu préparer la robe et me préparer en même temps ; "Tante" Anna m'avait dit : "Je m'occupe de la robe. Occupe-toi de tes cheveux et de ton maquillage." Je me sentais plutôt défaite aprés cette longue attente. Mais Lyon fut très gentil. Il me dit qu'il me trouvait si fraîche, si jeune, etc... Il dit même : "vous êtes la première que je découvre depuis Jean Harlow."Jean Harlow, entre nous, est ma préférée d'autrefois! Le lendemain, bien qu'il eût fallu normalement le consentement du Président directeur général ou de je ne sais qui, Lyon me glissa dans une série de bouts d'essaie en technicolor et, presque aussitôt, la Fox me signa un contrat.Un contrat de star, pour un an! En pure perte d'ailleurs. Je n'ai jamais su pourquoi, jamais compris. Ils engageaient des tas de filles et de garçons et les laissaient tomber sans leur accorder une seule chance. Ce fut mon cas. Mise à la porte, j'essayai de voir M. Zanuck. Impossible.Chaque fois, on me répondait qu'il était à Sun Valley. Semaine après semaine je revins à l'assaut : "Navré", me disait-on."Il est occupé, il est à Sun Valley." J'imagine il y est encore... bien que je l'ai revu, quand la Fox me reprit sous contrat, après ASPHALT JUNGLE.Il me dit : "Vous avez déjà été ici apparemment ?" - "C'est vrai." - "Que voulez vous, la roue tourne!" et il enchaîna en déclarant que j'avais "quelque-chose", une qualité à trois dimensions qui lui rappelait Jean Harlow ; ce qui fut très intéressant puisque ça avait été l'avis de Ben Lyon. Je dois beaucoup à Ben Lyon, il fut le premier à me donner confiance. Je lui doit aussi mon nom actuel. Un jour où nous cherchions pour moi un nom de cinéma, car je ne voulais pas garder celui d'un homme qui n'était pas mon père, j'insistai pour prendre celui du nom de jeune fille de ma mère: Monroe.Je tenais à conserver du moins une forme de lien avec mes parents. Il accepta Monroe, mais ce fut lui qui trouva Marilyn, parce que, dit-il, après Jean Harlow, l'actrice à laquelle je ressemblais le plus était Marilyn Miller, la fameuse vedette des comédies musicales de Broadway.Etrange, quand on y pense que me voilà devenue Marilyn Monroe pour l'état civil! Mais enfin, pour en revenir à notre histoire, j'étais donc sans rien. Saquée par la Fox, saquée par la Columbia un peu plus tard, quoique différemment.La Columbia m'avait du moins donné un rôle dans LADIES OF THE CHORUS.Un film affreux! Je jouais une danseuse de burlesque dont un type de Boston tombe amoureux. Horrible! Mais ce n'était pas la raison de mon départ. Le vrai motif tient à des circonstances plutôt étranges et, mettons, déplaisantes. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que... la vie est pleine de leçons. Je ne voyais pas d'issue. J'étais revenue aux jours les plus durs. J'habitais au Hollywood Studio Club. J'y étais très malheureuse : cela me rappelait l'orphelinat.J'avais des dettes et j'étais très en retard pour mon loyer. Au Club, on vous accorde une semaine de retard et, après, vous recevez un petit mot : "Vous êtes la seule à ne pas apporter votre soutien à notre merveilleuse institution.", etc. Et vous comprenez! Tant que vous vivez là, vous mangez deux fois par jour, petit déjeuner et dîner. Ce n'est pas toujours très bon, mais cela nourrit.Et vous avez un toit et un lit. Sans cela, où aller? Pas de famille. Rien. Personne. Et j'avais faim. Je sais, des gens me disaient : "Pourquoi ne pas chercher un job de vendeuse, quelque part?"Oui, pourquoi pas? Une fois j'ai essayé, dans un drugstore : on n'a pas voulu de moi parce que je n'avais pas terminé mes etudes de lycée. Et puis, comment dire?... ce n'était pas la même chose. J'avais été modèle et surtout je voulais devenir une actrice et il me semblait que, si je retombais, ce serait sans retour. On a raconté beaucoup de fables à propos du fameux calendrier.A l'époque où l'on a découvert la chose, j'avais déjà fait ASPHALT JUNGLE et j'étais de nouveau sous contrat avec la Fox, pour sept ans cette fois. J'entends encore la voix de celui qui m'appela au téléphone, des bureaux de la Publicité :"C'est vrai que vous avez posé pour un calendrier?" - "Bien sûr", dis-je. "Cela vous ennuie?" puis j'ai compris à quel point ils étaient bouleversés, car la voix reprit : "Eh bien, même si c'est vrai dites que non." - "Mais j'ai signé l'autorisation de vente! Comment voulez-vous que je mente?" Et, si contrariés qu'ils fussent, je dis la vérité. Mais quand les journalistes me demandèrent pourquoi et que je repondi : "J'avais faim", on crut à un bon mot.Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai beaucoup de mal à mentir. Cela m'a coûté assez cher dans la vie. il m'arrive de passer délibérement des choses sous silence, pour me protéger ou protéger les autres - qui n'a pas envie ou besoin de se protéger? - mais je ne mens jamais. J'avais faim et j'avais quatre semaines de loyer en retard ; je cherchais déséspérémment de l'argent.Telle est la vérité. Je me suis rappelée que j'avais posé pour les publicités de bière avec le photographe Tom Kelly, et que sa femme, Nathalie, avait suggéré que je devrais poser sans vêtements, en ajoutant qu'il n'y avait rien de mal à cela et que c'était bien payé : cinquante dollars, la somme dont j'avais besoin. Alors, comme ils avaient toujours été très gentils pour moi, j'ai téléphoné. J'ai commencé par dire à Tom : "Etes-vous sûr qu'on ne me reconnaîtra pas?" Il l'a promis. Puis j'ai demandé si Nathalie serait là. "Oui." - Mais ça devra être de nuit", ai-je insisté. "Après que vos assistants seront partis. Vous devrez vous debrouillez tout seul avec Nathalie pour les éclairages." Il a dit oui. Je suis venue.Ils se montrèrent d'une compréhension extrêmes ; ils me sentaient suffisamment bouleversée. Ils ont étalé un velour rouge.Ce fut vite fait, très simple, et plein de courants d'air. Mais je pus payer le loyer et manger. Les gens sont drôles. Ils vous posent de ces questions! Et si vous êtes franches, ils sont choqués! On me demande : "Qu'est-ce que vous mettez pour vous coucher?Un haut de pijama? Le bas? Une chemise de nuit?"Je reponds: "Une goutte de Chanel n°5", et l'on croit que c'est encore un bon mot, alors que j'essaie de répondre avec tact à une question grossière et indiscrète.Et puis, c'est vrai! Mais on ne le croit pas! Il fut un moment où je commençais à être... reconnue, disons, et où les gens n'arrivaient pas à imaginer ce que je faisais quand je n'étais pas sur le plateau, parce qu'on ne me voyait à aucune première, aucune représentation de presse, aucune réception. C'est simple : j'allais à l'école!Je n'avais jamais pu finir mes études, alors j'allais à l'Université de Los Angeles. Le soir. Dans la journée, je gagnais ma vie avec des petits rôles dans les films.Je suivais des cours d'histoire de littérature et d'histoire de ce pays ; je lisais beaucoup, de grands écrivains.C'était dur d'être à l'heure pour les cours. Je devais me dépêcher.Je quittais le studio à 6h30 et j'avais dû me lever très tôt pour être sur le plateau, prête, à 9 heures du matin. Souvent j'étais morte de fatigue ; il m'arrivait même de m'endormir en classe. Mais je me forçais à rester droite et à écouter.J'avais pour voisin un jeune noir, studieux et brillant : il me donnait l'exemple et cela m'aidait à rester éveillée. Entre parenthéses, c'était un humble postier à l'époque; il est aujourd'hui directeur des postes à Los Angeles. Le professeur, Mme Seay, ne savait pas qui j'étais bien qu'elle trouvât bizzare que des garçons des autres classes passaient parfois la tête à la porte, pendant les cours, pour me regarder en chuchotant.Un jour, elle se décida à interroger mes camarades, qui dirent : "Elle joue dans les films". Surprise, elle déclara : "Et moi qui la prenais pour une jeune fille fraîche émoulue du couvent!" C'est l'un des plus grands compliments qu'on m'ait jamais faits.Mais les gens dont je parlais tout à l'heure, eux, préféraient voir en moi une starlette frivole, "sexy" et stupide. C'est comme ma réputation d'être toujours en retard. D'abord, tout le temps, non!On se rappele seulement quand je le suis. Cela dit, je crois en effet que je ne peux pas aller aussi vite que les autres. Ils sautent en voiture, se rentrent dedans, sans répit... Je ne crois pas que nous soyons faits pour vivre comme des machines.D'ailleurs c'est tellement inutile! On travaille tellement mieux avec un peu plus de bon sens et de loisirs! Au studio, si je dois me presser pour répéter ou pour me faire coiffer, maquiller, habiller, j'arrive épuisée sur le plateau.Pendant que nous tournions LET'S MAKE LOVE, George Cukor, le metteur en scéne, a trouvé plus intelligent de me laisser un peu en retard mais plus fraîche. En tout ce que je fais, j'aime prendre mon temps. On se bouscule trop, de nos jours.C'est pourquoi les gens sont si nerveux et si malheureux en face de la vie et d'eux-mêmes. Comment peut-on faire parfaitement quoi que ce soit, dans ces conditions? La perfection demande du temps.J'aimerais devenir une grande actrice, une vraie, et être heureuse aussi parfaitement que possible. Mais qui est heureux? Le bonheur! Vouloir devenir une vraie actrice, tout cela demande beaucoup d'effort et de temps.
GEORGES BELMONT : J'imagine que ce portrait de la Duse, au mur, n'est pas ici pour rien?
MARILYN MONROE : Non. J'ai une grande tendresse pour elle. A cause de sa vie, comme femme et comme actrice. Comment dire?...Elle n'a jamais fait de concession, dans un cas comme dans l'autre. Personnellement, quand il m'arrive de réussir quelque chose dans mon métier, j'ai le sentiment de toucher à ce qu'on appelle le sommet du bonheur. Mais ce ne sont que des moments! Je ne suis pas heureuse, comme ça, en général.Si je suis quelque chose, en général, ce serait plutôt misérable comme un chien! Mes deux vies, professionelle et privée, me sont si personnelles, sont si étroitement liées, que je ne peux les séparer : l'une réagit constamment sur l'autre. L'ennui dans mon cas, je pense, c'est que je voudrais tant être merveilleuse!Je sais que cela fera rire certains, mais c'est vrai. Une fois, à New York, mon avocat me parlait d'histoires d'argent, en déployant une patience d'ange pour m'expliquer ça. A la fin je lui ai dit : "Je n'y comprend rien et je m'en moque.Je sais seulement que je voudrais être merveilleuse!". Dites cela à un homme de loi, il vous croira folle. Il y a un livre du poète Rainer Maria Rilke qui m'a beaucoup aidée : Lettres à un jeune poète. Sans lui, peut-être croirais-je par moments que je suis folle. Quand un artiste... je m'excuse, mais je considère que je suis presque une artiste, et là encore on rira sans doute ; c'est pourquoi je m'excuse...quand un artiste recherche à tout prix la vérité, il a parfois la sensation de frôler la folie. Mais ce n'est pas vraiment la folie. C'est seulement qu'on s'efforce de faire sortir ce qu'on a de plus vrai en soi-même ; et croyez-moi, c'est dur.Il y a des jours où l'on se dit : "Sois vraie, c'est tout!" , et ça ne sort pas. Et d'autres jours, c'est si simple! J'ai toujours eu le sentiment secret de ne pas être absolument sincère. Tout le monde sent cela, de temps à autre, je suppose.Mais dans mon cas cela va loin parfois... jusqu'à penser que, foncièrement, je ne suis qu'un monstre de fabrication. Lee Strasberg, le directeur de l'Actors Studio me répète souvent : "...Pourquoi es-tu si mécontente de toi-même?"Et il ajoute : "Après tout, tu es un être humain!" Et moi je lui réponds : "Oui, mais j'ai l'impression que je dois être plus que cela." - "Non!" me dit-il alors. "C'est cela que tu essaies de faire en ce moment?" - "Il faut bien que j'entre dans la peau du personnage, non?!" Et il répète encore : "Non! Tu es un être humain. Pars de toi-même!" La première fois qu'il m'a sorti cela, j'ai crié : "De MOI?" Et il a répondu : "Oui! De TOI!!".Après Arthur, Lee est probablement celui qui a le plus changé ma vie. C'est pourquoi j'aime tant aller à l'Actors Studio. A New York, j'y vais régulièrement. Je n'ai qu'une envie : faire de mon mieux, toujours, à tout instant. Sur le plateau, dès que la caméra se déclenche, je veux être parfaite, aussi parfaite que possible, jusqu'au bout.Quand j'étais à l'usine, le samedi soir j'allais au cinéma.C'était le seul moment où je pouvais me distraire, rire, être moi-même. Alors, si le film était mauvais, quelle déception! Toute la semaine, j'avais attendu et travaillé dur pour me payer cela. Si les acteurs me paraissaient jouer par-dessous la jambe, je sortais déçue comme si l'on m'avait trahie.Que me resterait-il pendant toute une semaine? C'est pourquoi, aujourd'hui, quand je travaille, je songe toujours à ceux qui travaillent aussi pour pouvoir aligner leur argent au guichet dans l'espoir de s'amuser. Ce que pensent les producteurs et le metteur en scéne, cela m'est assez égal : mais pas ce que penseront les gens en voyant le film.Un jour, j'ai essayé d'expliquer ça à M. Zanuck... L'amour et le travail sont les seules choses vraies qui nous arrivent dans la vie. Ils font la paire ; sinon, c'est boiteux. D'ailleurs, le travail même est une forme d'amour. A l'usine j'ai dit que je me dépêchais d'expédier mon travail parce que c'était fastidieux ; mais je me rappelle que, malgré tout, je mettais un point d'honneur à le faire exactement, aussi parfaitement que possible.Et si je rêvais de l'amour, c'était aussi comme d'une chose qui doit être la plus parfaite possible. Quand j'ai épousé Joe DiMaggio, en 1954, il ne jouait déjà plus au base-ball, mais c'était un merveilleux athlète et un être d'une grande sensiblité. Fils d'immigrants italiens, il avait eu une jeunesse difficile. Nous nous comprenions donc assez bien.Ce fut la base de notre mariage. Mais je dis assez bien. Et pour cela ce fut un échec. C'était fini au bout de neuf mois, malheureusement. Je mets le même point d'honneur à mes sentiments qu'à mon travail. Peut-être est-ce pourquoi je suis impétueuse et exclusive. J'aime bien les gens. Et quand j'aime je pousse l'exclusivité jusqu'à ne plus avoir qu'une seule idée en tête! Surtout, j'ai envie d'être traitée humainement.La première fois que j'ai vu Arthur Miller, c'était sur un plateau et je pleurais. Je jouais dans un film AS YOUNG AS YOU FEEL, et il passait dans les studios avec Elia Kazan.Je pleurais à cause d'une amie dont je venais d'apprendre la mort. On nous présenta. Je voyais tout dans un brouillard. C'était en 1951. Je restai quatre ans sans le revoir, après cela. Nous nous écrivions et il m'envoya une liste de livres à lire.Mais je me rappelle que, constamment, je songeais qu'il me verrait peut-être dans un film... on passerait deux films, ce soir là, et peut-être serais-je dans un et me verrait-il. Alors, quand je travaillais, je faisais encore plus de mon mieux... Je ne sais comment décrire cela. Je l'aimais, depuis le premier jour. Voilà, c'est tout.Jamais je n'oublierai qu'il dit, ce jour là, qu'à son avis je devrais faire du théâtre et que les gens autour de nous, sur le plateau, rirent en l'entendant. Mais il répéta : "Non, non, c'est très sérieux." Et le ton, son attitude, les circonstances firent que je sentis en lui un être profondément humain et sensible, et qui m'avait traitée comme une personne humaine et sensible, moi aussi.C'est le mieux que je puisse dire. Mais c'est le plus important. Depuis notre mariage, quand je ne tourne pas, nous menons une vie tranquille et heureuse à New York, et plus encore dans notre maison du Connecticut pendant les week-ends. Mon mari aime travailler tôt le matin. Il se lève en général à 6 heures. Il se repose ensuite dans la journée en faisant la sieste. Comme l'appartement n'est pas grand, j'ai fait insonoriser son bureau.Il a besoin de solitude totale quand il travaille. Moi, je me lève à 8h30 et quelques. Nous avons une excellente cuisinière. Parfois, en attendant mon petit-déjeuner, je vais promener mon chien Hugo. mais quand la cuisinière est de sortie, je me lève plus tôt et je prépare le petit déjeuner pour mon mari ; car je trouve qu'un homme ne doit pas s'occuper de ses repas. Je suis très vieux jeu à bien des égards. Je trouve aussi qu'un homme ne doit jamais porter à la main ce qui appartient en propre à la femme, souliers à hauts talons, sac, etc.Il m'arrive de cacher un peigne dans la poche de mon mari, mais c'est tout. Après le petit déjeuner, je prends un bain, pour changer des jours de travail où je me lève si tôt, parfois à 6 ou 5h du matin, que je dois prendre deux douches, une chaude et une froide pour me secouer. A New York, j'aime à me tremper dans mon bain en lisant les journaux et écoutant des disques. Après, j'enfile une jupe, une blouse, des souliers plats et une veste de polo et, le mardi et le vendredi, je vais à l'Actors Studios, à 11h, ou les autres jours aux cours privés de Lee Strasberg. Je rentre pour le déjeuner, que nous prenons d'habitude ensemble, comme le dîner.Nous écoutons des disques en mangeant. Mon mari aime comme moi la musique classique. Ou le jazz s'il est excellent, bien que nous réservions plutôt cela aux soirées où nous avons des amis qui aiment danser. Souvent, Arthur se remet au travail après sa sieste. Je trouve toujours à m'occuper pendant ce temps. Il a deux enfants de son premier mariage et je m'efforce d'être une bonne belle-mère. Et il y a à faire dans l'appartement.J'aime faire la cuisine, pas tellement à la ville où l'on est trop bousculé, mais à la campagne pour le week-end. Je fais du très bon pain, et les nouilles aussi très bien. Rouler, sécher, la cuisson et la sauce. Ce sont mes deux spécialités. Mais j'aime également inventer... J'adore les assaisonnements! L'ail! Souvent, j'en mets de trop pour le goût des autres. Il arrive que les acteurs avec qui j'étudie une scène pour les cours de Strasberg viennent à la maison, le matin ou l'après-midi et je leur prépare un petit-déjeuner ou le thé...Bref, les journées sont assez remplies. Mais toujours, j'ai soin d'être libre avant le dîner, pour mon mari. Aprés le dîner, parfois nous allons au théâtre ou au cinéma, ou des amis viennent, ou nous allons chez des amis. Mais très souvent, nous restons tout simplement à la maison, tous les deux, à écouter de la musique, parler ou lire.Ou encore, nous marchons dans les rues ou dans Central Park. Nous adorons marcher. Il n'y a pas de routine fixe dans notre vie. Il y a bien des moments où j'aimerai être plus organisée, faire certaines choses à certaines heures etc. Mais mon mari dit que comme ça, au moins, on ne s'ennuie pas! Alors, tout va bien. Et puis, personellement, les choses ne m'ennuient jamais. Ce qui m'ennuient, ce sont les gens qui s'ennuient. J'aime beaucoup les gens ; pourtant, parfois, je me demande si je suis vraiment sociable.La solitude ne me pèse pas. Cela m'est égal d'être seule. Même, j'aime cela.C'est un repos. Cela permet de prendre plus possession de soi-même, de se rafraîchir. Je crois qu'il y a deux aspects dans tout être humain ; du moins, c'est ce que je sens dans mon cas. On a envie d'être seul, et en même temps, envie d'être ensemble.C'est un vrai conflit. J'y suis sensible à un point suraigu. C'est pourquoi, j'aime tant mon travail. Quand j'en suis contente, naturellement je me sens plus gaie, plus sociable. Quand ça ne va pas, j'ai envie d'être seule. Et c'est la même chose dans ma vie...
GEORGES BELMONT : En sorte que, pour résumer, si je vous demande quelle impression cela fait d'être Marilyn Monroe, à ce stade de votre vie, que direz-vous?
MARILYN MONROE : Quelle impression cela vous fait-il d'être vous?
GEORGES BELMONT : Parfois je suis content du monde et de moi-même. Parfois, non.
MARILYN MONROE : Et vous êtes heureux comme ça ?
GEORGES BELMONT : Ma foi, oui.
MARILYN MONROE : Eh bien, moi aussi. Et comme j'ai trente quatre ans et encore quelques années devant moi, j'éspère, cela me laisse le temps de travailler à devenir meilleure et plus heureuse dans mon métier comme dans ma vie privée.C'est ma seule ambition.Peut-être y mettrais-je le temps, car je suis lente ; et je ne veux pas dire par là que ce soit le plus sûr moyen. Mais c'est le seul que je connaisse et qui me donne le sentiment que la vie, après tout, n'est pas sans espoir. 3 commentaires
3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
MARILYN MONROE





.gif)